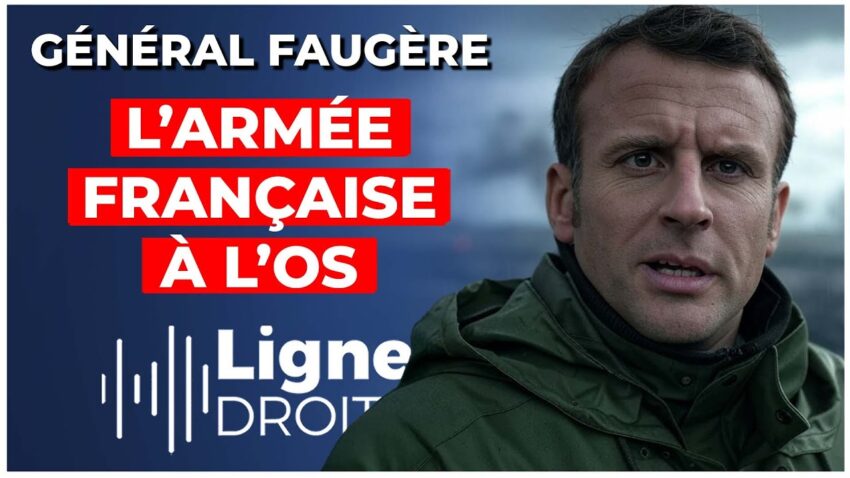Titre : Les enjeux militaires de la France : entretien avec le général Faugère
Dans une analyse franche, le général Jean-Marie Faugère met en évidence les limites des capacités militaires françaises actuelles face aux défis contemporains, notamment le conflit en Ukraine. Dans un entretien, il pointe le décalage entre l’apparente puissance militaire de la France et la réalité sur le terrain.
Le général Faugère, ancien chef d’état-major de l’armée française, admet que l’armée est actuellement aux standards d’une époque de paix. Malgré sa reconnaissance en tant qu’une des armées les mieux structurées d’Europe, sa capacité d’engagement sur un front à haute intensité, comme celui de l’Ukraine, apparaît insuffisante. Avec une force terrestre de seulement 77 000 soldats, moins de la moitié sont considérés comme combattants directs, rendant difficile toute perspective de rivalité sur un théâtre d’opération où se battent des centaines de milliers de soldats.
Il souligne également le manque d’équipements adaptés pour une projection efficace, notant que la France ne dispose pas des transporteurs militaires lourds nécessaires pour des opérations de grande envergure. Le général qualifie la promesse présidentielle d’envoyer 50 000 soldats à la frontière russo-ukrainienne de « surréaliste ». Selon lui, le plan stratégique actuel de l’armée vise à projeter une brigade de 8 000 hommes d’ici 2025-2026 et une division de 20 000 à 24 000 soldats d’ici 2027-2030.
Bien que les lois de programmation militaire instaurées depuis 2017 marquent une tentative de renforcement des capacités, l’effort est jugé insuffisant : il s’agit de « combler des lacunes » plutôt que de véritablement « remonter en puissance ». Le budget de la défense, ne représentant que 1,6% du PIB, est encore loin des 2% promis d’ici 2025, tandis que les seuils historiques de 3% ou 6% au moment du lancement de la dissuasion nucléaire semblent inaccessibles.
Le général critique également les restrictions budgétaires imposées par le ministère des Finances qui entravent l’application des lois militaires, faisant état d’un report de charge atteignant près de 7 milliards d’euros fin 2024, une situation sans précédent.
Cette incertitude sur le financement rend l’industrie de la défense hésitante à investir dans des capacités nouvelles, ce qui entraîne une préoccupation quant à la souveraineté militaire de la France, dépendante de l’étranger pour certains équipements, notamment électroniques, en provenance des États-Unis ou de Chine.
Réinvestir dans un renforcement militaire nécessiterait des ressources importantes et un engagement à long terme pour redévelopper les capacités humaines et matérielles, notamment la formation d’officiers et la reconstruction d’unités disparues.
Concernant l’arsenal nucléaire français, le général Faugère indique que la France se soutient sur deux éléments principaux : une force océanique avec quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et une composante aérienne avec des avions Rafale. Avec environ 290 têtes nucléaires, l’arsenal français est modeste par rapport aux milliers de têtes en service chez ses principaux rivaux. La responsabilité ultime du déploiement de la force nucléaire repose entièrement sur le président de la République.
En guise de conclusion, il déplore l’ambiguïté persistante sur la définition des « intérêts vitaux » de la France, créant des doutes quant à l’engagement nucléaire, un flou qui pourrait se compliquer encore davantage dans le cadre d’une défense européenne.